Journal de l'ASSIPHAR

n°8 Dec. 1998
Le Bulletin
Journal de l'ASSIPHAR

n°8 Dec. 1998
SOMMAIRE
Compte-rendu de la 3è journée de l’ASSIPHAR
DESINFECTION & STERILISATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX
Rédacteur en chef : Bénédicte Bastia
Comité de rédaction : Bernadette Coret, Valérie Archer-Corbrion, Anne Broussard, Isabelle Di Sandro, Christophe Pitré.
![]()
Association nationale des
Assistants et
anciens Assistants en Pharmacie Hospitalière
Le mot de la Présidente
Cher(e) Ami(e),
Ouf ! Nous avons mis le temps, mais ce numéro finit par paraître. Après chaque Journée de formation de l’ASSIPHAR, nous faisons le vœux pieux de vous en donner un compte rendu avant le concours de CNPH, et nous échouons. Acceptez nos excuses et croyez que nous ne désespérons pas de pouvoir y arriver.
Il est vrai que cette période été-automne est toujours délicate, car elle monopolise beaucoup nos neurones et notre énergie pour réviser ce " foutu " concours. De plus, le bureau c’est doté de beaucoup de sang neuf qui demande un certain temps pour prendre ses marques.
Mais j’ai la certitude que la nouvelle équipe ne vous décevra pas et que l’ASSIPHAR a encore de beaux jours devant elle.
Au chapitre concours, j’espèrais pouvoir vous donner quelques informations sur le projet de réforme de celui-ci. Beaucoup de bruits courent encore. Je ne me permettrais pas de démentir ou confirmer quoique ce soit, tant que je n’ai pas de certitudes venant de sources officielles ou bien informées. Cependant, je m’engage, dès que la douce euphorie de fin d’année sera passée, de partir en quête d’informations que je m’empresserai de vous communiquer.
Le seul point sur lequel je m’avancerai est que cette réforme implique aussi les médecins qui ne semblent pas avoir fini leurs négociations avec le ministère. Peut-être ne sera-t-elle pas mise en application cette nouvelle année ?!…
Affaire à suivre de très près ! D’autant que, outre le fait de modifier la manière de réviser, elle risque de chambouler les perspectives, déjà limitées, de trouver le poste de nos rêves.
Bon, cette projection d’avenir étant difficile à réaliser, je vous propose plutôt de faire un bref retour dans le passé et de vous délecter dans la lecture des résumés de communications de grande qualité.
J’en profite pour renouveler nos remerciements à l’ensemble des intervenants qui nous ont gentiment accordé leur temps.
A l’an que ven !
La Présidente,
Bénédicte BASTIA.
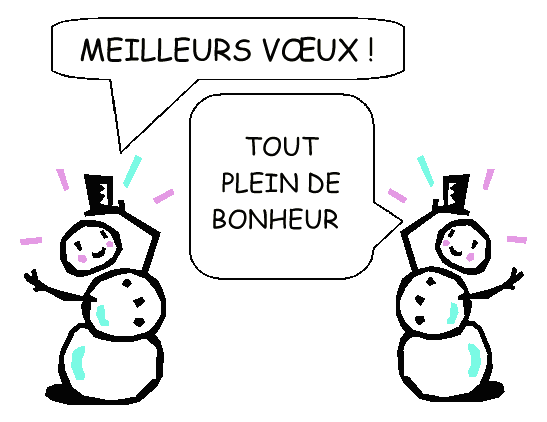
Le traitement des dispositifs médicaux : Les recommandations officielles
Catherine DUMARTIN
Ministère de la Santé, Paris
I- Quelques définitions :
Stérilisation = procédé qui rend un produit stérile et qui permet de conserver cet état pour une période précisée (Comité Européen de Normalisation CEN).
Stérilité = absence de microorganismes viables (Pharmacopée européenne, IIIème ed.).
Désinfection = opération au résultat momentané permettant d’éliminer ou de tuer les microorganismes et/ou d’inactiver les virus indésirables portés par des milieux inertes contaminés en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette opération est limité aux microorganismes présents au moment de l’opération 5AFNOR NFT 72101).
L’objectif de la stérilisation des dispositifs médicaux (DM) est bien défini alors que la désinfection implique de se fixer des objectifs d’élimination des microorganismes.
Paramètres permettant de déterminer le niveau d’exigence de traitement des microorganismes :
ü site
anatomique de destination du matériel
le DM est alors soit critique, semi-critique ou non critique
ü niveau d’asepsie de l’environnement (salle blanche) où le matériel va être utilisé
ü contamination du matériel par les liquides biologiques (précautions standards)
ü nature des matériaux et moyens technologiques (DM non stérilisables).
II- Circulaire DGS/DH n° 672 du 20 octobre 1197 relative à la stérilisation des DM dans les établissements de santé.
Les établissements de santé qui stérilisent les D.M. doivent apporter aux patients une sécurité et une qualité comparables à celles dont ils bénéficieraient si l’on utilisait des DM stérilisés dans l’industrie.
Objectifs de la circulaire :
l Rappeler l’importance de maîtriser un risque connu
Lorsqu’un risque est identifié et que les solutions pour maîtriser ce risque sont connues, on se doit de les mettre en œuvre.
Pour la stérilisation :
Dans un premier temps, il convient donc d’identifier les DM devant subir une stérilisation (instruments chirurgicaux, pinces à biopsie, utilisation dans un environnement aseptique…).
l Rappeler les bases réglementaires, normatives et les recommandations de bonnes pratiques.
l Promouvoir le développement d’un système qualité (SQ) à l’instar de ce qui est demandé en industrie.
En matière de stérilisation, l’instauration d’un SQ est incontournable. La stérilisation est un procédé spécial défini dans les normes EN 29000 c’est à dire un procédé dont "les résultats ne peuvent être entièrement vérifiés par un contrôle et des essais ultérieurs du produit… il convient de veiller à la validation des procédés de stérilisation avant leur mise en application, à la surveillance de leur fonctionnement en routine ainsi qu’à l'entretien du matériel. Un pilotage continu des opérations et un respect permanent des procédures documentées sont nécessaires pour assurer la conformité aux exigences spécifiées ".
l Etre un outil, une aide
La sécurité de la chaîne de traitements des DM passe par la motivation de l’ensemble des acteurs, la mise en place de procédures écrites, validées et évaluées, la formation du personnel, la pratique d’audit pour dynamiser le système.
III- Guide de bonnes pratiques de désinfection des DM (1998)
Contexte :
Absence de référentiels de désinfection contrairement à la stérilisation.
Objectifs :
Exposer la démarche à suivre pour déterminer la technique d’entretien appropriée et d’indiquer les moyens de mise en œuvre.
Contenu du guide : trois parties
En conclusion :
La diffusion de ces recommandations doit permettre aux établissements de santé de mettre en place un circuit de traitement des DM à usage multiple apte à garantir la sécurité des patients qui doit s’intégrer dans une démarche globale de qualité des soins utilisant les DM à usage multiple (cahier des charges lors de l’achat des DM à usage multiple, respect des règles d’asepsie lors de l’utilisation des DM, évaluation du bénéfice/risque à tout acte…)
Quelle méthode de stérilisation employer ?
Bénédicte BENOIT
Pharmacie, Hôpital Lariboisière, Paris
La stérilisation a pour but de diminuer le risque infectieux. Deux paramètres sont à prendre en compte :
DM non critiquesè destinés à la peau saine è doivent être propres
DM semi-critiqueè muqueuses et à la peau léséeè désinfectés ou stériles
DM critiquesè actes invasifsè stériles
L’état stérile est défini comme l’absence de micro-organismes. En pratique, le niveau d’assurance de la stérilité (N.A.S.) est la certitude de n’avoir, au maximum, qu’un risque sur 106 d’avoir une contamination (pharmacopée Européenne, Norme EN 556). La valeur stérilisatrice F0 dépend de la température du plateau. Par exemple sa valeur est de 18 minutes à 121°C pour Bacillus stearothermophillus. Sa valeur est multipliée par 2.5 et 25 à 125°C et à 135°C respectivement.
Depuis le 14 juin 1998, les DM sont marqués CE. Le fabricant doit précisé " si le dispositif est destiné à être réutilisé, les procédés de réutilisation, les informations relatives aux procédés appropriés pour pouvoir le réutiliser y compris le nettoyage, la désinfection, le conditionnement et le cas échéant, la méthode de stérilisation ainsi que toute restriction sur le nombre possible de réutilisation.
Les différents procédé de stérilisation :
Ÿ La vapeur d’eau
Méthode très fiable, sans résidus toxiques, procédé validé contre les ATNC, délai de mise à disposition faible, seul procédé où la validation paramétrique (sans attendre les résultats biologiques) est possible.
Ÿ La chaleur sèche : pas utilisée
Ÿ La radiostérilisation : méthode fiable, sans résidus toxiques, inscrite à la pharmacopée mais nécessite des installations lourdes, il existe des incompatibilités avec certains polymères, coloration.
Ÿ L’oxyde d’éthylène : peu utilisé, gaz toxique, cancérigène, explosif, inflammable, norme EN 550. L’indicateur biologique est bacillus subtilis.
Ÿ Gaz plasma : deux procédés peuvent être utilisés : le SterradÒ (peroxyde d’hydrogène, le PlazlyteÒ (acide peracétique et peroxyde d’hydrogène). L’installation est rapide, absebce de résidus toxiques mais il n’existe pas de normes, les indicateurs biologiques sont peu fiables, le coût des appareils et des consommables est élevé. Le procédé est incompatible avec la cellulose, le polystyrène, les objets creux et longs (diamètre interne < 1mm et longueur > 2m). L’indicateur biologique est Bacillus stearothermophilus.
Le procédé de choix est la stérilisation par la vapeur d’eau : ce procédé doit être utilisé chaque fois que cela est possible (Pharmacopée européenne, IIIème ed. 1997).
En conclusion :
Dispositif Médical
í î
Réutilisable Usage Unique
í î
Thermorésistant Thermosensible
í î
| Prions 134°C 18’ | Oxyde d’éthylène |
| 125°C | Rayonnements g |
| Gaz Plasma |
La limitation de la charge microbiologique initiale : nettoyants, décontaminants, désinfectants.
Delphine VERJAT
Pharmacie Centrale des Hôpitaux, Paris
La circulaire n°672 du 20 octobre 1997 rappelle que lors de la mise en place d’un système qualité en stérilisation, il convient de limiter la charge microbienne initiale. Ceci avait d’ailleurs été stipulé dans la pharmacopée européenne (janvier 1997). Il s’agit d’une étape majeure qui conditionne le résultat final du procédé de stérilisation.
Contamination des dispositifs médicaux (DM)
Aspects qualitatifs et quantitatifs :
Biocontamination = processus entraînant la présence de micro-organismes pathogènes ou potentiellement nocifs sur le matériel ou la personne (CEE).
L’aspect qualitatif varie selon le DM concerné : électrodes (risque prions), humidificateurs (BGN). Après utilisation, 105 à 109 germes /article sont retrouvés sur les D.M, alors qu’après traitement <103 germes/ article. Pour déterminé la charge microbienne, il existe des normes EN 1174 (1993) et ISO 11737-1 (1995). Le principe repose sur la validation du protocole de récupération des germes et la liste des éluants autorisés. L’évaluation de la charge microbienne initiale présente un triple intérêt :
Pour limiter la charge initiale, il est nécessaire de codifier les conditions d’utilisation (peu maîtrisables) ou les conditions de prétraitements.
La terminologie des prétraitements est un vrai casse-tête :
Décontamination ou pré-désinfection ?
Terminologie pour les produits :
Mise en œuvre de la pré-désinfection :
Critères généraux de qualité pour nettoyant-désinfectant :
La S.F.H.H a édité une liste positive des nettoyants-désinfectants.
Critères de choix :
ü Au niveau de la formulation :
ü emploi facilité
ü faible coût
Les Normes…
ü Phase I
| Nom | NF T 72 150/51 |
EN 1040 (1997) |
| Germes testés | Ps.
Aeruginosa S. aureus E. coli E. hirae (Mycobacterium smegmatis si spectre 5) |
Ps.
Aeruginosa A. aureus |
| Activité | Diminution de 5 log | Diminution de 5 log |
| Température | 20°C | 20°C |
| Temps de contact | 5 min | 1, 5, 15, 30, 45 ou 60 min |
| Nom | NF T 72 200/201 |
EN 1275 (1997) |
| Germes testés | Candida
albicans Penicillum verrucosum Cladosporum cladosproîdes Absidia corymbifera |
Candida
albicans Aspergillus niger |
| Activité | Diminution de 4 log | Diminution de 4 log |
| Température | 20°C | 20°C |
| Temps de contact | 15 min | 5, 15, 30 ou 60 min |
ü Phase II1 : bactéricidie en présence de substances interférentes
Circulaire n°100 du 11 décembre 1995
Correspond à la prise en compte du risque prions.
| Procédure III | Procédure II | Procédure I |
| Décontamination + nettoyage habituel | Décontamination + nettoyage alcalin | Décontamination + nettoyage alcalin |
| Soude 1N 1h | ||
| Soit
stérilisation 134-136°C 18 min Soit désinfection habituelle |
Soit
stérilisation 134-36°C 18 min Soit soude 1N 1h |
Soit
stérilisation 134-136°C 18 min Soit eau de javel ? |
| Désinfection du matériel non stérilisable ? | Désinfection du matériel non stérilisable ? |
Pour la mise en œuvre du nettoyage, utiliser de préférence les automates. Le nettoyage peut alors s’effectuer par aspersion, immersion ou ultrasons.
En conclusion :
Les étapes de décontamination et de nettoyage sont deux étapes primordiales dans le procédé de stérilisation puisqu’elles conditionnent le résultat final.
Système qualité en stérilisation
Sophie CARIOU
Pharmacie, Hôpital Saint Antoine, Paris
La stérilisation occupe une place primordiale dans la politique de lutte contre les infections nosocomiales. En raison d’un niveau d’exigence élevé et de l’impossibilité de contrôler le résultat, la garantie de stérilisation passe par la maîtrise de toute la chaîne de production. La construction d’un système qualité passe par 2 objectifs principaux :
La circulaire DGS :DH n)672 du 20 :10/98 stipule que l’obtention de l’état stérile et de son maintien constitue une obligation de résultat d’où la nécessité d’un système qualité.
La responsabilité du pharmacien est engagée au niveau des services de stérilisation lorsque les locaux sont intégrés dans la pharmacie à usage intérieur. Le pharmacien est responsable de la mise en place d’un système qualité.

La centralisation permet le regroupement des moyens et des compétences sous une même responsabilité. L’organisation rationnelle des locaux assure la continuité et la reproductibilité de toutes les étapes et réduit les risques de contamination croisée.
A toutes les étapes du procédé :
Les procédures et les documents de travail sont rédigés en conformité avec les référentiels professionnels. La traçabilité en production répond à deux exigences : qualité (ISO 9002) et matériovigilance (décret n°96-32 du 15-01-96).
La traçabilité permet un suivi rigoureux de toute la chaine de production avec la mise en place de documents d’enregistrements, la vérification du respect des procédures. C’est un outil adapté pour la détection des non-conformités.
Les enjeux liés à la mise en œuvre d’une démarche qualité sont la crédibilité et la reconnaissance externe, l’optimisation du fonctionnement général et le management (démarche volontariste, facteur humain prépondérant).
Pour construire un système qualité, 4 phases peuvent être distinguées :
En conclusion :
L’obtention de l’état stérile est une obligation de résultat qui passe par la mise en place d’un système qualité.
La validation en stérilisation
Isabelle HERMELIN
Pharmacie, Hôpital La Source, Orléans
Les essais à réaliser pour valider les stérilisateurs à vapeur sont décrits dans la norme EN 285. Quatre types d’essais sont décrits :
Quelques définitions :
- Qualification opérationnelle = obtention et documentation de preuves : l’équipement réceptionné fournira un produit acceptable s’il est utilisé conformément aux spécifications du procédé.
- Requalification opérationnelle = confirmer les données de la qualification opérationnelle 1 fois/an/type de charge.
Validation = procédure documentée pour obtenir, enregistrer et interpréter les résultats nécessaires pour montrer qu’un procédé donné sera toujours conformes aux spécifications prédéterminées.
= procédé global = réception + qualification opérationnelle.
Spécifications relatives au stérilisateur :
L’instrumentation nécessaire à la validation et le contrôle de routine des cycles de stérilisation doit être efficace, documentée et étalonnée. Plusieurs systèmes de mesures peuvent être utilisés : le thermocouple, la sonde de platine.
Mise en application :
1) Réception :
Les essais s’effectuent à vide et permettent de vérifier le bon fonctionnement du stérilisateur et des systèmes de mesure. Tous les essais doivent être spécifiés, documentés et enregistrés.
Le fabricant doit fournir :
2) Qualification opérationnelle
Elle a lieu après réception, après modification majeure sur un stérilisateur, ou 1 fois/an sur chaque type de charge pour s’assurer de la pénétration de chaleur dans les parties froides, les emballages. Elle s’effectue sur trois cycles pour s’assurer de la reproductibilité du stérilisateur.
En conclusion :
Les rapports de qualification sont approuvés et analysés par une personne qui n’a pas effectué les essais ou rédigé les rapports. Les données sont archivées dans le dossier d’assurance de la qualité du processus et utilisées pour la maintenance préventive des machines.
Les contrôles en stérilisation
Valérie CORBRION-ARCHER
Pharmacie, Hôpital Henri Mondor, Paris
Les contrôles à effectuer pour s’assurer de la qualité du procédé mis en œuvre sont décrits dans deux normes :
- EN 554 pour la stérilisation à la vapeur
- EN 550 pour la stérilisation à l’oxyde d’éthylène
Pour la stérilisation au Gaz Plasma, il n’existe aucune normes. Comme il s’agit d’un procédé basse température, par extrapolation, la norme EN 550 peut être utilisée.
Les contrôles s’effectuent à toutes les étapes du procédé : avant la stérilisation, le procédé de stérilisation, et après la stérilisation.
Les contrôles s’effectuent à différents niveaux : charge, équipement, cycle choisi, opérateur.
Archivage :
Surveillance de routine :
En conclusion :
Les stérilisateurs doivent subir des essais pour assurer la reproductibilité d’un cycle, tous les essais contrôles et matériaux utilisés doivent être spécifiés et documentés.
La traçabilité
Marie Odile BAUME
Pharmacie, Hôpital Saint Joseph-Saint Luc, Lyon
Eric BOURY
Pharmacie, Hôpital Saint Philibert, Lomme
Traçabilité = aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un produit ou d’un processus de délivrance d’un service au moyen d’identifications enregistrées (ISO 9001- 9002). La traçabilité s’inscrit dans un double objectif : économique (déterminer le coût d’une intervention chirurgicale) et sécuritaire. La traçabilité nécessite l’outil informatique : la traçabilité peut être centrée sur le conditionnement, le transport ou le stérilisateur.
En conclusion :
![]()
![]()
![]()
![]()
Christophe BURTIN, Past-Président de l’ASSIPHAR, clôture cette deuxième journée en remerciant les conférenciers pour la qualité de leurs interventions. Il remercie également l’ensemble des participants, nombreux et venus de toute la France. Il espère que le succès remporté par cette journée se perpétuera les prochaines années.
Par ailleurs, il rappelle le principe des journées de l’ASSIPHAR, à savoir l’intervention de "seniors" et d’assistants.
Si des sujets vous tiennent à coeur, n’hésitez pas à contacter le Bureau ou vos correspondants régionaux pour nous transmettre vos idées pour les prochains thèmes à aborder.
Assemblée Générale
Date : Vendredi 19 juin 1998
Lieu : Amphithéâtre CCI - CH Necker - Enfants Malades - PARIS
Ordres du jour :
- Rapport moral de la Présidente
- Rapport financier du trésorier
- Renouvellement des 3 sièges à pourvoir.
Présents :
- 86 personnes
- Le bureau : Bénédicte Bastia (Présidente), Christophe Burtin (Vice-Président), Muriel Silvie (Secrétaire), Isabelle Di Sandro (Secrétaire adjointe), Christophe Pitré (Trésorier), Delphine Bourin (Trésorière adjointe).
- Hervé Trout : Président d’honneur
- Catherine Dumartin : Membre fondateur
La Présidente présente le RAPPORT MORAL :
L’ASSIPHAR vient de fêter ses 3 ans. C’est un nombre clef, symbole d’équilibre. Mais il est aussi entaché pour la Présidente de tristesse, car il signe un au revoir des derniers pionniers du bureau. En effet, Delphine BOURIN, Muriel SYLVIE et Christophe BURTIN sortent, conformément aux statuts, du bureau.
L’ASSIPHAR, cette année s’était posée deux objectifs principaux : réaliser l’annuaire des assistants et sonder l’opinion des adhérents après les discussions intéressantes et houleuses de la dernière assemblée générale.
L’annuaire n’est pas encore " sous presse ", mais le premier pas a été franchi.
Par contre, bien que tous n’aient pas répondu au questionnaire, une analyse permet de faire ressortir quelques points clefs :
- Demande de formation en vue de présenter le CNPH : nous restons très humbles sur ce point. Néanmoins, nous avons continué à organiser avec les industriels des séminaires de formation. Et la réalisation d’une Journée ASSIPHAR annuelle n’est pas remise en cause. Enfin, le Bulletin continu à paraître, avec une fréquence, certes, un peu chaotique. Nous sommes toujours très attentifs à vos propositions.
- Défense du statut de l’assistanat. Ca reste toujours un problème dans la mesure où nous ne nous sommes pas constitué en syndicat, comme 63% des sondés l’approuve. Néanmoins, nos rapports avec les syndicats de PH sont toujours aussi bons. Ils sont très attentifs à nos requêtes, et continuent à nous défendre sans que nous les sollicitions. Par ailleurs, nous avons pris l’habitude d’informer Madame BOUQUET, au Ministère de la santé, les rares fois où nous avons décelé des postes de PH gelés. Nous avons aussi fait la demande de pouvoir participer au groupe de travail qui vient de se constituer au ministère, pour étudier la régulation des flux.
Dernier petit point, nous sommes hébergés sur le NET sur le serveur de l’ADIPH. Son président, Jacques TREVIDIC y met régulièrement nos pages à jours. Nous le remercions à nouveau pour sa disponibilité et sa gentillesse.
Voilà développé de manière rapide nos actions et nos orientations. D’autres chantiers sont en train de prendre forme, comme un rapprochement avec les cliniques.
Le trésorier présente le RAPPORT FINANCIER arrêté au 18 juin 1998.
Solde créditeur après la journée du 13/06/1997 : 11 760,15 Frs
Les dépenses sont représentées par la papeterie, les frais de mailing, les frais de transport et ceux relatifs à l’organisation de la journée.
Les recettes sont représentées par les cotisations et les subventions des laboratoires pharmaceutiques.
L’ASSIPHAR compte, au jour de l’Assemblée Générale, 155 adhérents.
Le quitus est donné au trésorier à la majorité absolue.
Les membres donnateurs pour l’année 1998 sont :
BAXTER
BAYER PHARMA
BOERINGER INGELHEIM
FOURNIER S.A.
GLAXO WELLCOME
GUERBET
HOECHST HOUDE
NOVARTIS
PARKE DAVIS
PFIZER
PHARMACIA UPJOHN
ROCHE
ROUSSEL DIAMANT
SANOFI WINTHROP
SCHERING PLOUGH
SERVIER
SMITHKLINE BEECHAM
UPSA
WYETH LEDERLE
LES ELECTIONS
Conformément aux statuts de l’association, 2 membres du bureau terminent leur mandat : Muriel Silvie et Christophe Burtin. D’autre part, Delphine Bourin démissionne.
Trois candidatures sont enregistrées : Anne Brouard (Saint Malo), Bernadette Coret (Aulnay s/Bois), Valérie Corbrion Archer (Créteil).
Seuls les membres à jour de leur cotisation ont droit de vote.
Les résultats sont les suivants :
Anne Brouard : 40
Bernadette Coret : 39
Valérie Corbrion Archer : 39
La nouvelle composition du bureau est donc la suivante :
| Président | Bénédicte BASTIA |
| Vice-Président | Christophe PITRE |
| Secrétaire | Bernadette CORET |
| Secrétaire adjoint | Valérie CORBRION ARCHER |
| Trésorier | Anne BROUARD |
| Trésorière adjointe | Isabelle DI SANDRO |
Selon la coutume, cette troisième Journée a été l’occasion de féliciter les lauréats du CNPH 1997 des types 1 et 3. La Présidente, au nom de l’ASSIPHAR, a offert plusieurs livres à Valérie Furlan et à Bruno Frimat.
La soirée
La journée de formation du 19 juin 1998 a été suivie par un dîner et une soirée. Malgré de " petits " incidents techniques, c’était une superbe soirée avec une ambiance chaude, très chaude dans le noir en raison de l’absence d’électricité. Merci à tous ceux qui ont su profiter de cette occasion pour faire la fête. Rendez-vous l’année prochaine !
Petite Annonce
Un professeur de français de l’Académie de Pharmacie de Perm (Russie) recherchait, avant l’été, un médecin ou un pharmacien français pour une collaboration dans la réalisation d’un dictionnaire pharmaceutique français-russe.
Elle avait déjà rédigé une bonne partie du document, mais souhaitait une aide, en ce qui concerne la justesse et la précision des termes français.
Sans doute n’a-t-elle pas encore trouvé de collaborateur !
Mme Margarita LAZAREVA
Chef du Département de Latin et de Français
Academie de Pharmacie de PERM
48, rue Lénine Perm
RUSSIE, 614600
E mail : gio@pharm.perm.su
Tel : 00.7.34.22.48.43.17
Journées Professionnelles
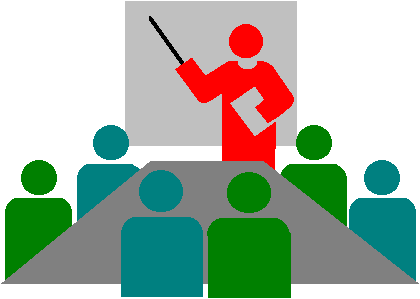
LA STRATEGIE DES MARCHES
Ce séminaire de formation organisé en collaboration avec les laboratoires BOERINGER INGELHEIM, c’est déjà déroulé à Paris.
Les deux intervenants, Mr Jacques LEBAS, pharmacien chef du CHR d’Orléan et Mr Henri BOUXIN, responsable des marchés du Laboratoire, nous ont offert une prestation de grande qualité.
Comme nous vous l’avions évoqué, une deuxième session se déroulera à Marseille, le 25 mars 1999.
Renseignements :
Isabelle Hermelin Jobet. Tel : 02.38.60.57.47
L’organisation de ce type de séminaire demande un investissement important du bureau et des industriels. Merci de respecter vos engagements ou de nous avertir le plus tôt possible en cas d’empêchement.
A Vos Agendas...
Visite de l’usine BAYER à Leeverkusen
Du 11 au 13 mars 1999
Le Laboratoire Bayer Pharma a la gentillesse d’organiser pour notre association un voyage-visite de leur usine située près de Cologne, en Allemagne.
Le nombre de place est limité. Les plus rapides à répondre, lors de l’envoi de l’inscription, seront pris en compte.
A vos starting block !
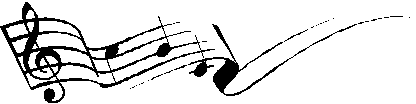 Rubrique Interactive
Rubrique Interactive
Voici la petite chanson élaborée par les membres fondateurs du bureau, dont les derniers éléments venaient de rendre le tablier !
On s'est réuni
Autour de Trouty
Il avait les statuts
Et il nous a dit
Y'a plus qu'à monter le Bureau
Avec n'importe qui
N'importe qui
Et ce fut nous
Six volontaires
Presqu' désignés
Et Christoph' comme Président
Ca s'imposait
Oh ! A L'ASSIPHAR
Oh ! A L'ASSIPHAR
De Larib à Saint Louis
De Necker à Saint Antoine
Une équipe venait d'se former
Pour démarrer
Des idées
On en avait
Les financer
Pas si aisé
Mais les Labos sollicités
Sont Arrivés
Oui les Labos
On a taxé
Pa scompliqué
Car nos aînés
Les avaient bien habitués
De ce côté
Oh ! A L'ASSIPHAR
Oh ! A L'ASSIPHAR
En Journées ou en Congrès
A midi ou à minuit
On ne perd pas une occasion
De se marrer
Y' avait Mumu
Vice-Présidente
Savoir râler
Son sixième sens
Et les coups de gueule d'Isa et Delph
On s'en rappelle
Y'avait Mumu
Notre cuisinière
Et la p'tite blonde
Du Ministère
Qui souvent savait nous rappeler
De n'pas s'emporter
Oh ! A L'ASSIPHAR
Oh ! A L'ASSIPHAR
D'l'association aux syndicats
D'y a qu'à faut qu'on, à qui fait quoi
Y'avait toujours de bonnes raisons
De s'engueler
Le Président
Devenu PH
Il a fallu
Le remplacer
Pour c'tte fonction, on a élu
Notre Béné
Et du logo
A l'édito
Du transport
A l'imprimeur
Elle monte toujours au créneau
Dès qu'il le faut
Oh ! A L'ASSIPHAR
Oh ! A L'ASSIPHAR
De Paris à Marseille
De Bayonne et jusqu'à Brest
Que d'occasions de s'rencontrer
On a créé
On s'est dit
Et des Journées
Ca pourrait être
Une idée
C'est facile à organiser
On le croyait !
Et un Bulletin
Pour échanger
Et des soirées
Pour l'env'lopper
Après nos routeurs préférés
Vous les enverraient
Oh ! A L'ASSIPHAR
Oh ! A L'ASSIPHAR
Des réunions, on en a fait
Mais pas toujours, pour avancer
Hreusement qu'après on s'restaurait
Mais pas à vos frais
L'année d'après
Est arrivé
Un beau Breton
Très motivé
Et des idées, il en avait
Pour nous aider
Sur notre avenir
Il a bossé
Un questionnaire
A concocté
Et même les cordons de la bourse
Il a géré
Oh ! A L'ASSIPHAR
Oh ! A L'ASSIPHAR
De Paris à Marseille
De Bayonne et jusqu'à Brest
Que d'occasions de s'rencontrer
On a créé
Aujourd'hui
Tous réunis
On passe la main
Et c'est la vie
Les petites nouvelles sont pleines de pep's
Pour nous remplacer
Et les galères
On oubliera
Les souvenirs
On gardera
Nous sommes fiers de vous confier
Notre Bébé
Oh ! A L'ASSIPHAR
Oh ! A L'ASSIPHAR
Des amis, on a trouvé
Et ça c'est sûr, on n'est pas près
De l'oublier !